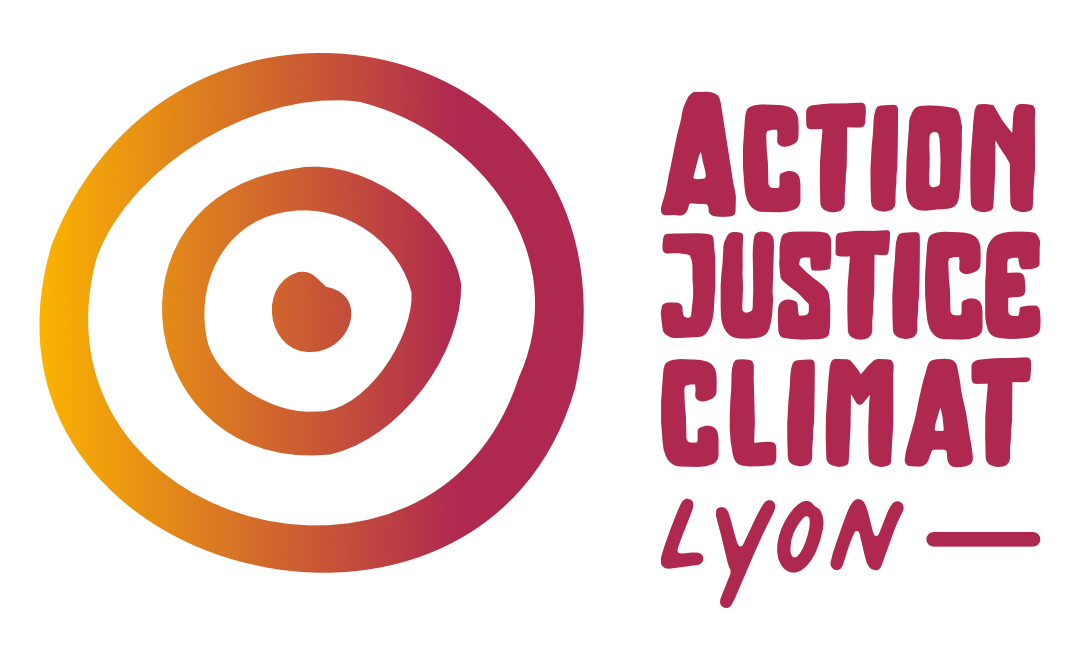Alors qu'une zone à trafic limité sur la presqu’île de Lyon est mise en place depuis le 21 juin 2025, les voix de commerçant•es se font entendre, craignant la fuite de leurs client•es, qui ne pourront plus se garer au plus près du lieu de leurs achats.
Ce discours du « no parking, no business » est souvent proclamé dès qu’il s’agit de supprimer des places de stationnement ou de rééquilibrer la place occupée par la voiture en ville.
Mais ces craintes sont-elle fondées ?
Des enquêtes montrent un décalage entre la perception des commerçant•es et la réalité des consommateur•ices. En effet, les commerçant•es surestiment la part de leurs client•es venant en voiture.
Par exemple, à Lille, alors que 42 % des client•es se déplacent à pied, seuls 21 % le font en voiture et 28 % en transport en commun (Source, Mathieu Chassignet).
Ce décalage de perception vient aussi du fait que commerçant•es et artisan•es sont celles•eux qui utilisent le moins les modes alternatifs. C’est pourquoi ils ont tendance à penser que leurs client•es utilisent majoritairement la voiture. Ce n’est qu’un ressenti et une projection de leur comportement sur leurs client•es. D’ailleurs, selon le Cerema (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), les client•es qui se déplacent à pied ou à vélo sont également les client•es les plus dépensier•es. Leur panier moyen d’achat par commerce est inférieur à celui d’un•e automobiliste mais leur fréquence de visite est plus importante, ce qui au global en fait des client•es plus fidèles.
Les automobilistes expriment également plus fréquemment leur mécontentement auprès des commerçant•es vis-à-vis des conditions de circulation et de stationnement. « On ne peut plus se garer dans le quartier » peut être entendu plusieurs fois par jour par les commerçant•es. A contrario, les piéton•nes formulent bien moins souvent ce genre d’agacement alors même que les cheminements sur les trottoirs peuvent être entravés par des véhicules mal stationnés.
Par ailleurs, plus de stationnements ne signifie pas plus grand succès commercial. Les espaces disponibles sont souvent utilisés par les résident•es et travailleur•ses pendulaires à proximité et non par les acheteur•ses. Ajouter des places de parking engendre donc une augmentation de la congestion et rend les hypercentres répulsifs de par les embouteillages interminables.
Au contraire, les client•es réclament des espaces plus agréables et sécurisés avec moins de bruit et de pollution et dans lesquels on puisse marcher dans de bonnes conditions, déambuler d’un commerce à l’autre. Ils et elles sont de plus en plus sensibles à leur impact sur l’environnement et plus enclin•es à venir dans des centres-villes apaisés, végétalisés où le cadre urbain est plus authentique et chaleureux que dans les centres commerciaux.
De très nombreux exemples de réussite de la piétonnisation pour les commerces le prouvent en France et en Europe : Strasbourg, qui a très largement piétonnisé son centre ville est une des villes de France arrivant le mieux à contrer l'essor du commerce de périphérie par rapport au commerce de centre-ville. Une étude a également montré que la piétonnisation mise en place dans 14 villes espagnoles de diverses tailles a, dans tous les cas étudiés, amené une forte augmentation du chiffre d'affaire des commerces.
Enfin, des exemples marquants de piétonnisation autrefois indésirée et finalement bénéfique existent également en Belgique comme à Bruxelles où d'anciens grands boulevards routiers ont été piétonnisés, à Liège ou encore à Gand.
Finalement, ces transformations ne seraient-elles pas l’occasion de repenser les usages de la ville et des zones piétonnes, et de les voir autrement qu’un « centre commercial à ciel ouvert » ? Ne plus mettre au cœur de nos villes l’image de l’automobiliste consommateur•ice, c’est rééquilibrer l’espace public et donner l’occasion d’offrir plus de place aux lieux de rencontre (nombreux•ses sont celles et ceux qui se « retrouvent en ville » en fin de semaine), aux espaces pour flâner et redécouvrir les richesses historiques et culturelles qui les composent.



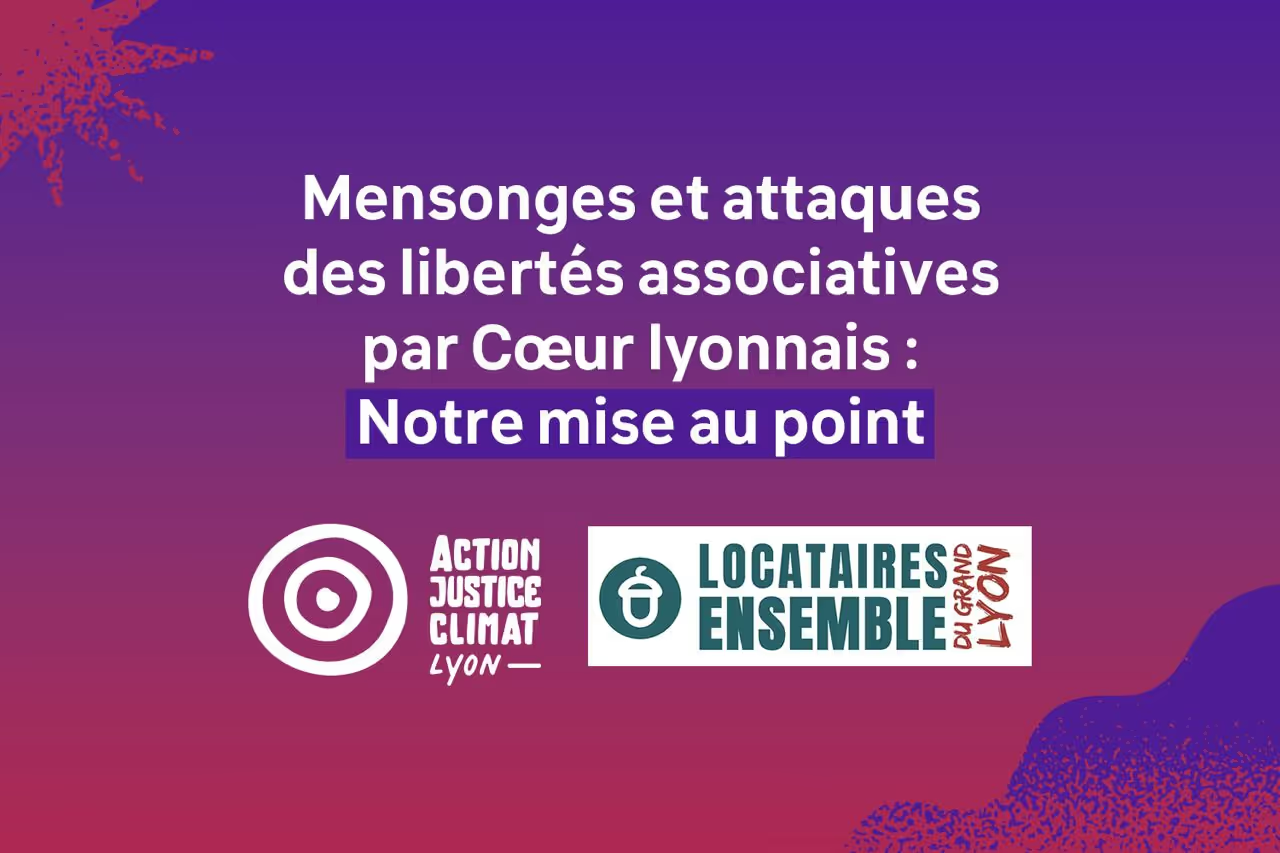
.avif)